J'aime les mots. Je ne sais pas si je tiens ça de ma mère, qui m'a fait découvrir avec bonheur les dictionnaires de synonymes, ainsi que l'étymologie, ou de mon besoin de nommer correctement les choses, pour mieux les décrire, au plus juste de mes ressentis. On me dit parfois dans la vie courante que je "joue sur les mots", pour décrire certaines personnes ou situations. Il n'en est rien. Je n'aime pas, simplement, qu'on utilise un registre lexical inapproprié ou des mots galvaudés par un mésusage dans le langage commun au point que leur soit assimilé un sens qu'ils n'ont pas.
Exemple: beaucoup de personnes, ces derniers temps, utilisent à mauvais escient l'adverbe "excessivement". Ainsi ai-je entendu une connaissance dire à propos d'un tiers "il me fait excessivement confiance". Or, toutes les personnes prenant part à cet échange savent bien que Louis est une personne fiable. La langue française est loin de manquer de synonymes à "totalement", pourtant: par exemple absolument, complètement, à fond, à plein, complètement, en bloc, entièrement, totalement, foncièrement, fondamentalement, généralement, in extenso, intégralement, jusqu'au bout, jusqu'aux oreilles, parfaitement, pleinement, profondément, radicalement, remarquablement, rigoureusement, royalement, strictement... Ce sont des équivalents linguistiques.
"Excessivement" relève d'un autre champ lexical: celui de l'excès, du risque, et donc a un aspect négatif non négligeable. Une personne qui l'utilise dans un tel contexte prend le risque d'être accusé de malhonnêteté, d'incorrection, de fourberie. On me fait confiance, mais excessivement, car je peux prendre des libertés avec ce sentiment de sécurité.
J'ai bien conscience que le mode d'expression de chacun varie. Selon l'âge, le niveau d'instruction, l'activité professionnelle, le milieu social, le type de relation entre celui qui s'exprime et de la personne à laquelle elle s'adresse, les circonstances de la communication (orale, écrite, solennelle, décontractée, etc.), on utilise généralement pas les mêmes termes ni la même syntaxe.
Le registre de langue permet d'adapter son discours en sélectionnant les mots, les expressions, les tournures syntaxiques, voire la prononciation les plus adéquats, selon la situation.
Il y a trois niveaux de langue ordinairement reconnus : familier, courant, soutenu. Mais on distingue aussi des registres plus précis : poétique, littéraire, très familier, vulgaire, argotique, populaire, jargon, didactique, rare, etc. Certains mots ou expressions n'appartiennent à tel ou tel registre que dans certains de leurs emplois.
Or, le choix des mots est important pour moi.
Je ne suis pas à le recherche du politiquement correct.
Je suis à la recherche de mots qui expriment ma pensée, mes ressentis, mes actes et ceux des autres de manière neutre, autant que possible. J'aime que les choses soient factuelles, avant tout.
Comme tout-un-chacun, j'aime traduire la force de mes émotions, positive ou négative, pour une situation, une activité, un ressenti. Mais je n'aime pas donner une force sentencieuse et définitive à mes propos.
Il me semble qu'utiliser un registre péjoratif à mauvais escient, c'est une forme de violence. En effet, il s'agit de termes à la connotation négative, par laquelle le locuteur exprime désapprobation, dérision, mépris ou dégoût pour ce dont il parle. Des termes fortement péjoratifs peuvent constituer des insultes ou des injures.
Il me tient à cœur de préciser une chose: ne juge pas les personnes qui communiquent principalement ainsi. Cependant, il m'est pénible de les côtoyer. En effet je perçois dans leurs discours une sorte de danger. Mes besoins ne sont tout simplement pas en adéquation avec ce type de discours (généralement oral, donc).
Il me semble que les personnes qui utilisent ainsi de manière récurrente voire constante des termes vulgaires et/ou très marqués négativement ont des motivations intrinsèques à se positionner ainsi. Le percevoir et le comprendre, c'est différent de le cautionner. D'une certaine façon, c'est répondre aux violences exercées par des situations subies par une autre violence, qui se répand telle une aura, un champ d'influence, sur les tiers étrangers au(x) problème(s).
J'essaie quant à moi d'utiliser une communication réellement respectueuse. De moi-même et des autres. Cela m'apporte beaucoup de sérénité dans la vie, de la confiance en moi, du calme. Les mots qu'on choisi d'utiliser sont importants. Ce sont des fenêtres, ou des murs.
La communication non violente est un engagement de tous les jours et, d'une certaine manière, une sorte de thérapie. Selon la métaphore de Marshall B. Rosenberg, je suis une apprentie girafe.
Je fais du mieux que je peux, de mon côté.
Je ne cherche pas à imposer aux autres la CNV. Il doit, selon moi, s'agir d'une attitude volontaire et consciente, pour qu'elle soit utile à ceux qui la pratiquent.
Cependant... il m'est devenu de plus en plus pénible, avec le temps, de côtoyer des personnes qui utilisent exclusivement des modes de communication empreints de négativité, de jugements et d'agressivité.
Je préfère me tenir à distance, pour préserver ma paix intérieure.
Ces dernières années, j'ai véritablement pris conscience de ma sensibilité aux attitudes et aux mots. Ceux des autres, mais les miens aussi, bien évidemment. J'aspire à ce que le langage, quel qu'il soit (verbal, écrit, physique...) soit avant tout au service de ce que je veux vivre d'épanouissant et de positif.
•••••
Ce billet, comme tant d'autres, m'a été inspiré par un événement de vie.
Une amitié remontant à 2017. Des épreuves subies par cet ami, dans lesquelles je l'ai soutenu, en 2018, puis fin 2020 et pour finir, pendant près de deux ans, dans des conditions qu'il ne méritait aucunement de subir. Cet ami, qui sera toujours cher à mon cœur, a changé. Il a perdu en légèreté. Il était déjà provocateur et rebelle aux systèmes établis. Il est devenu dur, violent, dédaigneux, méprisant, agressif, injurieux et vulgaire. Je connais ses raisons. Je vois dans son attitude une forme d'autoprotection, un refuge aux violences morales et institutionnelles qu'il a subi.
J'avais prévu de passer quelques jours chez lui, après trois ans sans le voir.
Je n'ai passé que 26h en sa compagnie.
Je ne regrette rien : j'étais heureuse de le revoir.
J'en avais besoin, et je crois que lui aussi.
Je ne regrette rien : j'étais heureuse de le revoir.
J'en avais besoin, et je crois que lui aussi.
Cependant, sa façon d'être d'aujourd'hui n'a plus la légèreté et l'insouciance qui me plaisaient tant. Pire, elle m'a tellement irritée que j'ai fini par hausser la voix et crier, face à une diatribe vulgaire et agressive contre une personne en particulier. Tout ce qu'il disait, je le savais déjà, je connaissais le fond de sa pensée. Le choix des mots m'a fait violence, et j'ai décidé de me mettre en sécurité et de partir.
Je suis sereine, au lendemain de cet incident.
Bien qu'il l'ai fait à mon sujet, je ne le juge pas et conserve une grande bienveillance pour lui.
À une distance sécurisante.
Je me suis écoutée et j'ai été bienveillante, vis à vis de moi comme vis à vis de lui.
Merci à Létitia Marre, dite Léti Gribouille pour son travail formidable d'illustration et de promotion de la Communication Non Violente. Son Petit guide illustré de la communication pacifiante reste toujours à porté de ma main, quand je suis chez moi. Ses cartes d'Energie des Besoins et des Ressentis et Emotions m'accompagnent également dans ma recherche d'épanouissement. À découvrir et commander sur le site d'Apprentie Girafe, c'est une mine!
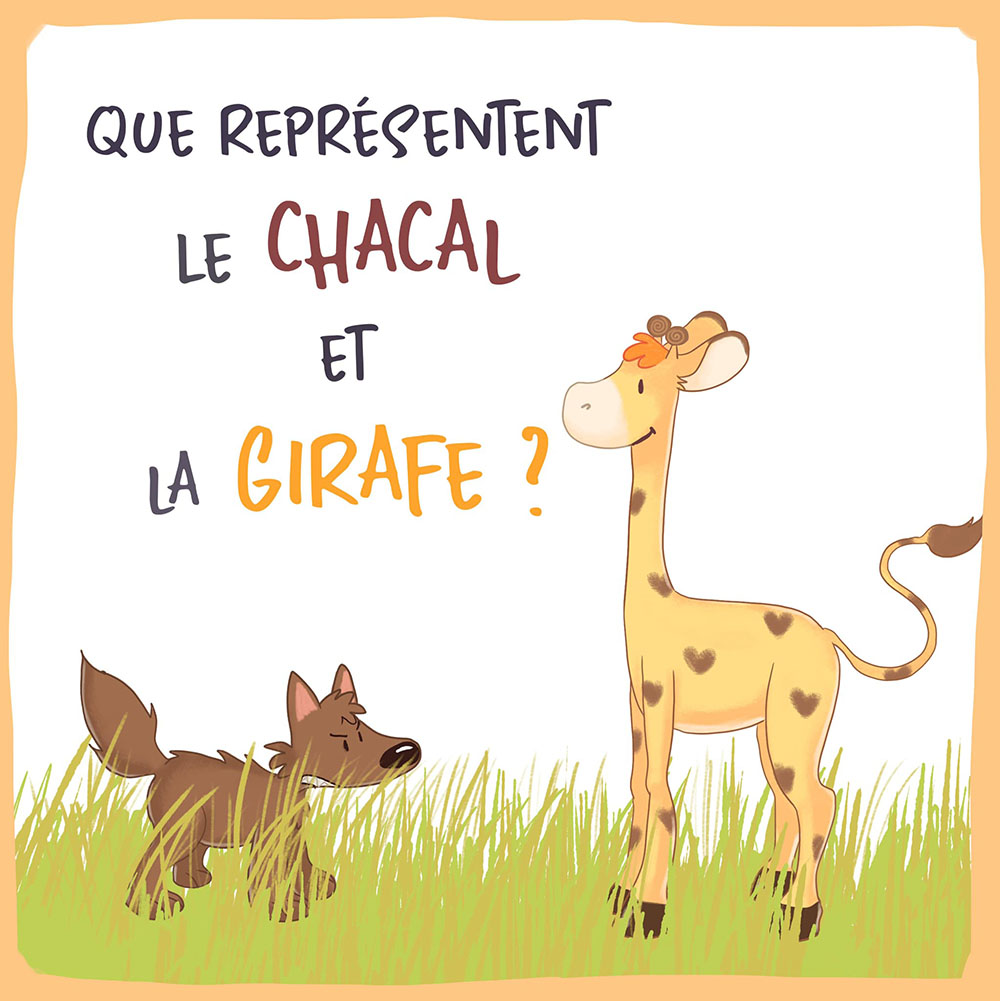
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Un petit mot, ça fait toujours plaisir...
Mais comme je n'aime ni les machines ni les trolls, je modère tout de même un peu ^^