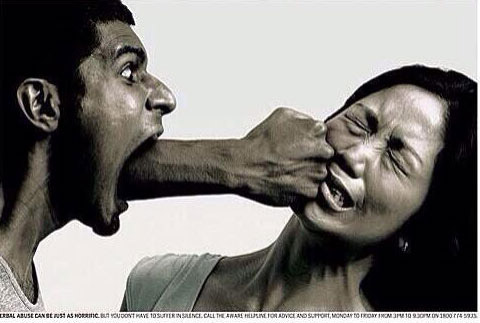J'avais un peu laissé en plan le récit de mon histoire, ces derniers mois, m'étant arrêtée à l'
épisode 1 de mes années lycée... Il serait peut être temps de m'y remettre?
En décembre 1999, je démissionne du lycée pour essayer le CNED. Je suis bien décidée, même si je doute profondément de ma capacité à réussir à étudier seule. Mais je veux échapper à tout prix à l'univers du lycée et de l'internat.
Le hasard a voulu que pendant les vacances de Noël, les deux plus grandes tempêtes de mon existence s'abattent sur la France. Le 26 décembre un ami de Paris m'apprend que toute est dévasté chez lui...
Cet ami est un élément important et mérite une mise en contexte.
Relationnel...
Car de cet ami, Stéphane, je m'en sentais alors follement amoureuse. C'était un auteur pour enfants et avait 20 ans de plus que moi. Il avait fait une intervention dans l'école de ma mère, alors que j'étais en troisième et que je révisais le brevet. Nous l'avions hébergé à la maison, et comme j'écrivais, je lui avais fais lire quelques uns de mes textes à sa demande (j'en avais parlé au cours du dîner, et il avait demandé à le lire... et je n'avais pas osé refusé, tout en étant flattée).
Après son départ, nous avion gardé le contact par Internet et nous échangions quelques mails mêlés de folie gamine très proche de l'univers des shadoks. Des relations "bon enfant".
Quand j'étais en seconde, il avait fait un passage par Angoulême, au printemps, et nous avions passé un mercredi après-midi ensemble. Il m'avait offert "L'enfant penchée", un album de bande dessinée des Humanoïdes associés.
À cet époque, j'avais un petit ami "atypique". Autrement dit qui avait 11 ans de plus que moi, et avec qui je ne "sortais" pas, mais restais plutôt enfermée, entre les draps. Sauf que... sauf qu'après des mois à ne pas vraiment se voir, ce "copain" qui ne s'intéressait guère à moi, et dont finalement je ne connaissais pas grand chose, a fini par rompre en septembre 1999.
Le hasard (la malchance?) a voulu que ce soit ce moment là que choisisse S. (mon ami auteur) pour me déclarer (toujours par mail) qu'il "ressentait des sentiments pour moi qu'il ne devrait pas ressentir". J'étais en détresse, en mal d'amour, et j'ai foncé tête baissée. Je l'ai "cuisiné" pour savoir ce qu'il entendait par là, jusqu'à ce qu'il écrive textuellement "Je t'aime" dans un message.
Explosion de joie de ma part! ♥♥♥ Il m'aime (je suis donc sauvée, car même si Y., lui, ne m'aime plus, quelqu'un d'autre m'aime quand même). Mon angoisse de l'abandon avait trouvé un nouveau grigri protecteur.
Oui, je sais, j'ai un discours désabusé.
Et pour cause...
Nous sommes nous revus, après cette déclaration? A-t-il sauté dans un train pour passer une après-midi, une journée, un weekend, avec moi ?
Non.
Nous avons continué de nous écrire. C'est tout.
Enfin, surtout moi, d'ailleurs. Des messages passionnés, d'ailleurs, où je continuais un peu nos délires... sans lui. Et où j'évoquais ma vie à moi. Sans que lui ne s'étale pour autant sur sa vie à lui (dont, finalement, je saurais peu de chose).
Un jour, passionnée, exaltée par le besoin de me sentir plus proche de lui, je cherche et trouve son numéro de téléphone dans l'annuaire... étrange, le numéro n'est pas à son prénom, mais c'est la bonne adresse, alors je tente.
C'est comme ça que j’apprends qu'à 36 ans, il vit encore chez ses parents !
Il est retourné y vivre, en fait, après une rupture.
Je suis choquée qu'il ne m'en ai pas parlé plus tôt, mais je continue à être dévorée de passion pour lui, malgré la distance et l'absence. Amour par correspondance. Est-ce vraiment possible d'aimer, ainsi, pour de vrai ? Je ne sais pas. En tout cas à l'époque, je veux aimer, je veux être aimée, et comme je ne sors pas, n'ai pas d'amis, n'ai aucune sorte de chance de trouver quelqu'un d'autre qui veuille de moi, et bien je l'aime, lui. C'est presque un dieu, tellement je l'aime et ai besoin d'être aimée de lui. Je me livre toute entière à lui dans mes écrits et mes coups de téléphone.
C'est comme ça que le 26 décembre j’ai appris qu'une tempête (Lothar, c'était ça, son petit nom...) avait dévasté le nord de la France, le matin même. Aux infos télévisées, nous avons appris qu'une nouvelle dépression, baptisée "Martin" se dirigeait vers notre région. Dès 16h30, nous avons commencé à entendre le bruit effrayant des rafales. Les coteaux charentais présentent des reliefs dans lesquels les vents se sont engouffrés et ont causés des dégâts effroyables.
Je suis fascinée par les tempêtes et orages, et cette fois là n'a pas fait exception à la règle, même si les détonations des branches qui cassaient partout alentour me faisaient un peu peur.
Assez vite, nous nous sommes retrouvés dans le noir, sans courant électrique, sans chauffage autre que la cheminée (même les chaudières à gaz ont besoin de courant pour fonctionner).
Le lendemain, notre prunier était par terre, le sapin penchait à 45° au dessus du sol, un grand peuplier s'était renversé, et partout autour de chez mes parents, la tempête avait laissée son empreinte. Et malgré mes efforts, je n'étais pas catastrophée, mais toujours fascinée, comme si tout cela n'était finalement qu'un jeu, un événement parmi d'autres...
Malaise...
Le 31 décembre 1999 au matin, l'électricité est revenue. La voisine, copine d'enfance de ma sœur aînée organisait un dîner de réveillon pour ses amis de toutes part. Cette voisine, je ne m'étais jamais entendue avec. Elle s'était toujours montrée désagréable à mon égard, avait toujours considéré que, en tant que petite sœur, j'étais un parasite, une créature ennemie, et me l'avait toujours bien fait sentir. Pourtant elle m'avait invitée à son grand réveillon.
Pour faire du chiffre.
Je me faisais une joie d'accompagner ma sœur ce soir là.
Mais confrontée à la trentaine d'invités, je me suis sentie instantanément mal.
La sensation n'était pas nouvelle. Je l'avais déjà éprouvée, quelques mois plus tôt, alors que j'étais encore en seconde, dans mon grand lycée, et que j'avais accompagnée ma sœur à une fête d'anniversaire chez d'autres amis (une soirée épouvantable, pour laquelle je m'étais collée une indigestion à coup de pains au raisins dévorés dans l'après midi, suivi d'un repas l'anxiété vissée au ventre, le tout achevé en boite de nuit où l'un des membres de la bande m'avait renversée une bouteille de whisky sur le pantalon en voulant enjamber une table).
Non seulement le nombre de convives m’effrayait, mais en plus la "maîtresse de maison" avait prit le partit de "placer" ses invités. Et de m'éloigner de ma sœur, me plaçant en bout de table, loin même des personnes que j’appréciais le plus, assise en bout de table, auprès de filles qui, m'avaient-elles confié, se demandaient elles aussi pourquoi elles avaient été invitées : vagues copines de lycée, elles aussi avaient la sensation d'être là pour occuper des chaises.
Les choses se sont peu à peu dégradées, et mon angoisse a monté à chaque étape. D'abord les apéritifs. Je ne buvais pas une goutte d'alcool, à cette époque. Or plusieurs personnes ont cherché à me servir de force. Ensuite, quand les entrées sont arrivées, on m'a servit ma coquille de surimi, et on a "vérifié" la suite. La suite, ce devait être des huîtres, sauf pour ceux qui n'aimaient pas ça, lesquels auraient des moules. On m'a donc dit que je prendrais des moules. Ma soeur avait pourtant bien précisé, quelques jours plus tôt (j'étais là), qu'elle n'aimait pas les huîtres, mais que moi si... d'où un conflit bien involontaire.
Après cela, alors qu'une bonne heure s'était déjà écoulée depuis notre arrivée, que je ne trouvais toujours rien à dire à mes voisines, que je n'avais pas même pu échanger quelques mots avec les amis de ma sœur, la maîtresse de cérémonie a décrété qu'il fallait faire une séance photo. Bien entendu, c'est elle qui a décidé qui serait sur celles-ci. Je n'ai été invitée à être sur aucune.
Je n'en ai plus pu. J'avais l'estomac au bord des lèvres, les larmes qui montaient à me faire battre le crâne, le cœur tendu à exploser dans la poitrine. Je me suis levée, ai simplement dit à ma sœur que je ne me sentais pas bien, ai traversée la rue et suis restée presque une heure à pleurer sur le pas de la porte. Je n'osais même pas rentrer chez moi. J'avais trop honte de moi, d'avoir une fois de plus "tout fait foirer", de m'être enfuie ainsi, comme une voleuse, comme une coupable.
Ensuite je suis rentrée en toute discrétion, ai attrapé le téléphone pendant que mes parents et ma grand-mère regardaient les émissions de réveillon et suis allée téléphoner à mon "amour" pour lui confier tout mon malheur.
À minuit je suis réapparue dans le salon.
Je ne me souviens plus ce que j'ai pu dire.
CNED...
C'est ainsi qu'a commencée mon année sabbatique. Pas d'autre nom.
J'ai si peu étudié.
Quand j'ai reçues les brochures du CNED, qui s'accumulaient dans ma chambre en une pile dangereusement haute, j'ai été enthousiaste, pourtant. Je voulais tout lire, étudier seule, être une bonne élève, persuadée que tous mes problèmes venaient du système scolaire en lui même, de mes mauvaises relations avec mes camarades, de l'incompréhension récurrente de mes enseignants (oui, c'est toujours la faute du prof...^^).
Sauf que...
J'ai toujours eu du mal à étudier. Soit je comprends tout de suite, et tout va bien, soit je ne comprends pas, et je me braque. Une fois dans cette disposition d'esprit, il devient très difficile pour moi d'étudier et de comprendre les notions. C'est comme si tout mon être ne cessait plus de répéter "je n'y arriverais jamais jamais jamais jamais...". Dès que j'essaye de contredire cette ritournelle, je me trouve un peu plus bloquée encore. Cette façon d'être génère une profonde honte de moi même ("je suis nulle"), et une crainte non seulement de décevoir les autres, mais en plus qu'ils portent un jugement sur moi ("elle n'essaye même pas", ou bien "elle est paresseuse").
J'ai toujours été comme ça, même à la primaire. Mais avec les années, le problème s'est amplifié et a empiré, jusqu'à ce que je soit complètement bloquée.
Tant que j'étais scolarisée en établissement scolaire, ça allait encore à peu près, car je devais respecter des délais. Or, quand l'urgence se faisait plus pressante que la volonté de bien faire, je faisais mes devoirs tête baissée (aux deux sens du terme), en cessant de réfléchir, et j'arrivais donc tout de même à produire quelque chose (souvent mauvais, ou passable).
Au début janvier 2000 j'ai donc essayé de m'attaquer à ma nouvelle scolarité.
Mais la seule lecture des consignes relatives au bac de français m'a donné des sueurs froides.
Je n'y comprenais rien.
Il y a des dizaines d'ouvrages sur la liste, et comme je ne savais absolument pas comment ça se passerait le jour de l'examen, mon angoisse déjà terrible en était devenue paralysante.
Plusieurs fois j'ai essayé de m’atteler sérieusement au travail, mais à chaque fois, j'ai eu l'impression que tout ça était absolument insurmontable, et bien entendu, j'ai rejeté l'idée même de demander de l'aide.
D'ailleurs en parlant d'aide, j'allais au CMP, à cette période.
J'y voyais un pédopsychiatre... mais pour ça, j'étais obligée de parcourir 17 kilomètres aller et retour en scooter. Un véritable périple pour moi. Je me souviens qu'à chaque fois j'avais peur de me perdre, qu'à chaque croisement j'étais au bord des larmes. Mais je m'étais engagée auprès de ma mère à consulter, et j'obéissais.
J'étais incapable de dire à qui que ce soit que ces trajets m'épuisaient nerveusement. Que ce soit à mes parents ou au psychiatre.
D'ailleurs, j'étais toute aussi incapable d'évoquer la nature de mes vrais problèmes, dont je ne me rendrais d'ailleurs compte que des années et des années plus tard.
Alors un jour, l'angoisse est devenue trop forte, et je n'y suis pas allée.
J'ai écris au psychiatre, incapable (déjà) de téléphoner.
J'ai laissé tombé et me suis repliée sur moi même.
Quelques fois, quand même, je suis allée à Angoulême par le bus, ai revus mes anciens camarades de classe. Mais je n'ai pas insisté... je ne me sentais pas d'affinités particulières avec eux.
N'étudiant pas, j'avais des journée remplies de télévision, d'Internet et de pâtisserie. De coups de téléphone à mon "amoureux" d'Île de France. De lettre manuscrites que je lui envoyais, aussi (sans recevoir de réponses, d'ailleurs).
J'ai aussi commencé à prendre des cours à l'auto-école, où j'allais toujours en scooter, pour prendre les cours de code. J'avais 17 ans et demi, il était temps de s'intéresser à la chose.
Je me souviens que j'étais tremblante les premières fois où j'y allais. Je faisais des erreurs stupides, que je ressassais sans arrêt (et je me souviens de certaines comme si c'était hier).
J'avais vite intégré les heures creuses, pendant lesquelles j'étais quasi certaine d'être seule dans la salle de projection, mon boitier à la main. Je n'avais bien entendu absolument pas conscience de l'évitement mis ainsi en place.
Le début des cours de conduite a été éprouvant. Pendant toutes mes heures de conduite, j'ai cherché à me donner contenance, à avoir l'air à l'aise, en papotant en permanence. Mais j'éprouvais de grosses difficultés à me concentrer et à avoir suffisamment confiance en moi pour intégrer les manœuvres que je devais intégrer.
Je bénéficiais de leçons de deux heures, aux moments calmes de la journée, puisque je n'étais pas dépendante d'horaires de lycée.
Malgré cet aspect positif de ma situation, je restais très anxieuse, et j'ai fais de grosses erreurs, au cours d'heures de conduite, comme de mettre mon clignotant à gauche (première route dans mon champ de vision) alors que le moniteur m'avait demandé de prendre la première à droite. D'ailleurs j'ai encore dans la tête la route, un virage à droite, dans les bois, la route à gauche au milieu du virage, et la "bonne", en haut de la côte et du virage, à la sortie des bois. Et de la colère de Denis, le moniteur, qui m'accusait de ne pas faire attention, de mon angoisse, de ma colère, de ma détresse, ce jour là.
J'ai été obligée d'avouer que mon babillage permanent ne servait qu'à une seule chose : masquer mon état d'angoisse permanent, à chaque leçon.
C'était peut être bien la première fois que je faisais un tel aveux à qui que ce soit.
Je me savais déjà nerveuse, depuis des années.
Mais j'en étais encore à croire que j'étais "comme ça" et que ça ne changerait pas...
En avril 2000, j'ai passé mon Code et je l'ai eu. Par contre en juin, mes heures de conduite ont été annulées, parce que je n'avais pas l'âge de passer l'examen (session le 21 juin... alors que je suis née le 22). La secrétaire de l'école de conduite m'a dit qu'elle me rappellerait dans l'après-midi pour me redonner des heures... mais elle ne l'a pas fait. Et moi, avec ma peur du téléphone (que je n'arrivais pas à formaliser), j'ai attendu plusieurs jours avant de faire la démarche... assez de temps pour que les cours de conduite soient complets jusqu'en août, vacances d'été obligent.
Vers une re scolarisation.
Peu à peu, ma mère s'est mise à me parler du lycée autogéré de Paris, le
LAP. Il était en effet devenu évident que cette année de tentative de scolarité par correspondance était un échec complet, et qu'il fallait absolument que je réintègre un établissement scolaire, quel qu'il soit. Je voulais m'intégrer, avoir mon bac, aller à l'université "comme tout le monde".
J'ai acceptée la proposition.
Il n'est venu à l'idée de personne (même pas à moi), à l'époque, de me faire intégrer le tout petit lycée de la ville du coin, Ruffec, quitte à ce que je change de section, quittant L arts plastiques pour Économique et Social... ce qui m'aurait placée à 18 kilomètres de la maison, vers le CMP décentralisé où j'étais allée consulter.
En tout cas, une fois contacté, le LAP nous a renvoyés vers le
CEPMO (Centre Expérimental Maritime en Oléron), basé à l'époque à Boyardville. Ma mère m'a proposé d'aller à la journée portes ouvertes, qui devait se tenir au mois de mai, à l'époque... C'était à 150 kilomètres de la maison.
Je me souviens que je me suis faite jolie, que j'ai portée une robe, alors que j'étais plutôt abonnée des pantalons. J'avais envie d'être originale, de ne pas avoir l'air coincée.
Mais je me suis mise une pression effroyable, sans doute invisible pour les autres, mais terrible pour moi. La lettre de motivation a été une épreuve à rédiger. Et l'entretien de pré-inscription a été pire encore. Je me souviens de mes sueurs froides dans cette salle de chimie, mais pas des questions. Sauf qu'elles me faisaient peur, que j'avais peur du piège, de ne pas être prise, de ne pas être appréciée, et d'avoir cherché à plaire, impérativement. La seule chose dont je me souvienne avec précision, c'est qu'un des profs m'a demandé si je n'avais pas de loisirs, des envies pour moi, ou quelque chose comme ça, et que j'ai dis que j'aimerais bien apprendre à jouer du piano. Dire que ça fait 12 ans, et j'ai encore cette réponse, avec ma peur dans le corps, qui reste imprimée en moi.
Après ça, j'avais envie de pleurer, de me cacher.
J'étais avec mes deux parents, je ne sais plus comment s'est passé le reste de la journée. J'étais simplement terrorisée à l'idée de ne pas être prise, comme s'il s'était s'agit d'une grande école, sans être capable le moins du monde de me rendre compte que l'entretien ne devait pas du tout servir à sélectionner les futurs élèves, mais simplement à élaborer au mieux le futur projet individuel de scolarisation.
Toujours est-il que mon dossier a été accepté.
Il a fallut trouver un logement, car le lycée ne disposait pas d'internat.
Je ne me souviens plus comment on a choisit le logement, à Saint-Denis d'Oléron.
Aujourd'hui le lycée occupe de nouveaux locaux, ayant déménagé de Boyardville vers Saint-Trojan. Mais voici une photo des locaux que j'ai fréquentés, et un lien vers le site actuel du lycée :
Amours d'été ?
Pendant des mois, j'ai attendu un signe de Stéphane, mon "amoureux" yvelinois... Sans rien voir venir. Finalement, un jour j'ai osé lui proposé d'aller au Futuroscope ensemble. Prendre le train, le retrouver, s'amuser, et peut être, qui sait, passer un plus long moment avec lui ?
C'était un mardi, je m'en souviens. Mais de l'organisation, aucun souvenir des choses. Était-ce en avril, comme il me semble ? Ou en mai ? Ou en juin ?
Aucune idée. J'aurais même des doutes sur l'année, si je m'en laissais l'occasion. Mais quand j'y réfléchit, ça ne peut être que cette année là.
Comment ai-je fait pour prendre le train, aller le retrouver ? Je ne sais pas non plus. À croire que je fais un blocage sur mes réussites.
À la gare, il était en retard. Et la pire des choses, j'avais peur de ne pas le reconnaître. Imaginez : je l'avais rencontré pour la première fois quand j'avais 16 ans, j'en avais désormais presque 18, et entre temps, nous ne nous étions vus qu'une seule fois, plus d'un an auparavant. Pas de photos d'échangées, même s'il avait un site internet, et que j'y avais récupérées quelques clichés.
Comment pouvais-je me dire amoureuse de lui? Et bien quand on ressent des chose, on déteste que les autres viennent vous contredire... donc même si mon entourage essayait un peu de me mettre en garde contre mes sentiments auto-alimentés, je ne voulais pas prendre en compte ce que les autres me disaient. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais Stéphane, qu'il m'écoutait, qu'il s'intéressait à moi... même s'il ne faisait aucun effort pour venir me voir, alors que c'était lui qui m'avait déclaré sa "flamme" ?
J'ai compris bien plus tard que derrière son "je t'aime" se cachait un autre sentiment, qu'il avait dû juger trop honteux pour l'avouer à une gamine de 17ans : du désir. Il aurait pu écrire "j'ai envie de toi, je rêve de toi, de te faire l'amour", ce jour là, dans son mail... aveu qui aurait évité un quiproquo qui a duré des années, mais ce n'était sans doute pas moralement acceptable à ses yeux.
Malheureusement cette honnêteté aurait sans doute mieux valu qu'un aveu déguisé, maquillé, qui m'a finalement enfermée des années durant dans une passion sans avenir possible.
Ce jour là, donc, je l'ai retrouvé à la gare de Poitiers.
Je ne l'ai pas trouvé beau. Je l'ai trouvé gros, il avait la brioche de la quarantaine approchant. Il m'a fait la bise, mais ne m'a pas embrassée. J'ai été déçue.
J'ai eu un pincement au cœur, mais ai choisi de l'ignorer. Je voulais continuer à l'aimer, coûte que coûte, sans prendre l'expression à la légère.
De la journée, finalement, j'ai peu de souvenirs. Sinon que je n'aimais pas son rire idiot dans les cinémas dynamiques. Qu'il s'est endormi dans la salle IMAX. Car il était sortit avec des amis la veille, à Paris, qu'il s'était couché à 2h du matin, puis était venu en TGV à Poitiers pour me rejoindre. D'ailleurs il a perdu son téléphone portable, tombé de sa poche, que nous avons du retourner chercher un peu plus tard.
J'aurais du sentir que tout ça ressemblait à une sortie "entre potes", mais je n'ai rien voulu voir. Je voulais l'aimer, même s'il ne me plaisait pas, même si j'étais déçue. J'étais "amoureuse" de lui depuis des mois. Il était inacceptable pour moi de me renier, comme ça, d'un seul coup. Pourtant, aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas ça justement qu'il était venu chercher ce jour là...
Je n'ai pas aimé sa façon de m'embrasser. Notre premier baiser, sur la grande passerelle, au dessus des bassins. Il embrassait en tendant les dents, en choquant les miennes contre les siennes. Un baiser d'adolescent, qui ne sait pas caresser de ses lèvres et de sa langue, qui se contente de se plaquer contre l'autre.
Je n'aimerais jamais sa façon de m'embrasser.
Et malgré tout cela je restais "amoureuse".
Le soir... à 17 heure ou un peu plus nous sommes repartis. J'ai pris un billet de TGV pour Ruffec, et lui a rejoint la gare de Poitiers pour remonter sur Paris. Même pas de baiser fougueux d'adieux. Je n'avais pas vraiment envie de l'embrasser. J'étais déçue, perturbée, déboussolée.
Et pourtant, j'ai continué à dire à qui voulait entendre que tout allait bien, que nous nous aimions, et à lui trouver mille et une excuses pour ne pas venir me voir.
Tout l'été, j'ai espéré une visite, une excursion, un voyage. Mais rien de rien. Le néant.
Mes parents sont partis en vacance, me confiant la maison. Stéphane avait parlé de venir me voir. Il ne l'a pas fait.
Finalement, fin août, alors que je devais emménagé dans mon logement de Saint-Denis, il a accepté de venir passer quelques jours avec moi. Quelques nuits à l'hôtel, puis une nuit dans "mes" murs, avant de repartir, le jour où mes parents m'aideraient à m'installer.
Je crois bien que c'est ma mère qui a réservée la chambre. Quand j'y pense, je me dis que c'est absurde. Mais en même temps je sais que c'est elle qui m'a accompagnée à Saint-Denis, ce jeudi là.
J'étais la première à l'hôtel. Stéphane est arrivé par bateau. Je lui ai même trouvé un charme tout nouveau, les cheveux et l'écharpe au vent, alors que la navette de La Rochelle abordait le port de Saint-Denis.
Le premier soir a été parfait, et sans doute est-ce la raison pour laquelle j'en garde peu de souvenirs. Nous avons passé un temps fou à discuter dans une crêperie, c'était magique, j'étais heureuse. Pourtant le soir même, sur la jetée, il n'a pas su combler mes attentes, me prendre dans ses bras. Il a téléphoné, à je ne sais trop qui, je me suis sentie seule, abandonnée. Et puis j'ai été malade...
Et puis on est allés ensemble récupérer les clés de mon logement... mais pas de draps, et nous avions quitté l’hôtel. La dernière nuit a été épouvantable, abrités d'une seule couverture. Une aventure qui aurait pu être savoureuse, mais qui m'a laissé un gout amer.
Le lendemain, Stéphane partait, mes parents m'aidaient à emménager, et une nouvelle année scolaire commençait.